PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

Dans le tourbillon frénétique du dérèglement climatique, l’Afrique n’est pas un spectateur, mais une victime de choix. La Guinée est frappée par de graves inondations et voit l’eau des pluies se transformer en fardeau dévastateur. Au-delà de l’aspect d’aménagement urbain, ces phénomènes s’expliquent aussi par une perturbation climatique. Elle est l’une des conséquences de l’industrialisation traditionnelle des pays qui passe par une forte accumulation des gaz à effet de serre depuis des siècles.
Visiblement, les pays africains ont très peu contribué à l’accumulation des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Notre participation est de 3.3% des émissions mondiales de GES entre 1960 et 2020 (MO IBRAHIM, rapport juillet 2022). Elle est donc marginale comparée à celle des pays développés comme les États-Unis ou l’Union européenne, qui sont historiquement les plus grands émetteurs. Pendant des décennies, des siècles, les développements économiques de l’occident ont été bâtis sur des modèles fortement émetteurs de carbone (charbon, puis pétrole et gaz) en omettant les conséquences sur notre planète.
Même si certains pays africains exploitent aussi ces énergies fossiles, leur part dans les émissions mondiales reste toutefois modeste. Par exemple, si l’Afrique subsaharienne exploitait toutes ses réserves de gaz, cela ne ferait passer sa part dans les émissions mondiales que de 3% à 3.5% (DG de AIE lors de la COP 27). La part de la Guinée dans les émissions globales de GES est < 0,1%6 (CDN GUINEE 2021).
En dépit de cette faible responsabilité dans le changement climatique, l’Afrique subit de plein fouet ses conséquences, avec des phénomènes extrêmes tels que les sécheresses, la montée des eaux, les inondations et des pertes agricoles qui affectent gravement ses populations.
Pour réparer cette injustice historique entre pays riches et pays pauvres face au changement climatique, le financement du climat a été mis en place pour permettre aux pays en développement de limiter leurs émissions tout en s’adaptant aux impacts déjà inévitables. Ce financement est une sorte de compensation financière par le principe du pollueurs-payeurs en faveur des pays en développement victimes. Mais leur mise en œuvre reste un défi au regard des prérequis et des résultats pour atteindre les objectifs financiers fixés.
Ce mécanisme de compensation est inscrit dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) depuis 1992, qui établit que les pays développés, responsables historiques des émissions, doivent aider financièrement les pays en développement en fonction de leur capacité et responsabilité.
Pour rappel, au début des années 2000, la mise en place des marchés du carbone a commencé à émerger. L’accord de Paris sur le climat en 2015 a pris le relais après le Protocole de Kyoto (2008-2012) et depuis lors, la portée des mécanismes de marché du carbone a été élargie à tous les pays (développés et en développement) et a introduit le concept de “mécanismes de marché non liés au marché” pour la coopération volontaire.
Dans l’article 6 de l’accord de Paris, des nouvelles règles pour le commerce international des réductions d’émissions ont été établies pour chercher à corriger les lacunes et critiques des mécanismes de Kyoto (notamment les failles de la qualité de et du double comptage).
Dans ce contexte, la République de Guinée dispose des atouts pour l’absorption des GES grâce à sa végétation. Celle-ci joue un rôle crucial et multidimensionnel dans la lutte contre le changement climatique, agissant à la fois comme un atténuateur (en réduisant les gaz à effet de serre) et un adaptateur (en aidant les écosystèmes et les sociétés à faire face aux impacts).
Grâce à la photosynthèse, les arbres et autres plantes forestières absorbent le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère et nous avons une opportunité d’émettre des crédits carbone sur le marché local et international. Le carbone peut être stocké dans les forêts pendant des décennies, voire des siècles. Les forêts sont le deuxième plus grand réservoir naturel de carbone sur Terre, après les océans (CCMF)
Notre pays dispose d’environ 17,1 millions d’hectares de forêt naturelle en 2020 (selon Global Forest Watch). Selon un article de Planet-Vie (Ecole Normale Supérieure de Lyon), la densité des stocks dans les forêts tropicales et boréales est autour de 240 tonnes de carbone par hectare.
L’utilisation des forêts pour générer des crédits carbone repose sur le principe de la séquestration ou de l’évitement des émissions de carbone. Il faut également le faire certifier et enfin vendre les crédits générés sur le marché.
Mais cela passera par :
•Quel cadre institutionnel à mettre en place ?
•Comment attirer les investisseurs ?
•Comment vendre notre carbone absorbé par nos arbres ?
•Comment aider les communautés locales à contribuer pour préserver cette forêt qui nous pourrait régénérer de la richesse ?
Pour répondre à ces différentes questions, nous avons fait quelques réflexions ci-après :
Le cadre institutionnel et une politique claire
Il s’agit de mettre en place une base juridique, organisationnelle et fonctionnelle qui renforce la cohérence, la légitimité et l’efficacité du projet.
Cadre juridique et réglementaire : voter des lois et édicter des règlements spécifiques qui encadrent la génération, la vérification, l’enregistrement, l’échange et l’annulation des crédits carbone. Cela inclut :
– La définition des types de projets éligibles (foresterie, énergies renouvelables, gestion des déchets, agriculture durable, etc.).
– Les règles de gouvernance pour les entités impliquées (développeurs de projets, vérificateurs, registres).
– Les règles d’allocation des bénéfices pour assurer un partage équitable des revenus avec les communautés locales.
– Les directives pour éviter le double comptage des réductions d’émissions (très important si le pays souhaite revendiquer ces réductions pour ses propres NDC – Nationally Determined Contributions ou les transférer dans le cadre de l’Article 6 de l’Accord de Paris).
Feuille de route nationale : Élaborer un document stratégique qui décrit la vision, les objectifs, les secteurs prioritaires, les mécanismes de mise en œuvre et les délais pour le développement du MVC (marché volontaire de carbone).
Cette vision nationale pourrait s’inscrire dans le cadre SIMANDOU 2040 des autorités. Il est également important de noter que l’exploitation de la mine de Fer Simandou contribue d’une certaine mesure dans la décarbonation dans l’industrie métallurgique en raison de sa haute teneur en fer souvent supérieure à 65%. Cela signifie que le minerai brut nécessite moins de traitement d’énergie pour être transformé en acier.
Développer les capacités institutionnelles et humaines
Désigner une autorité nationale : un organisme gouvernemental (une agence dédiée) doit être désigné comme point focal pour le MVC (Marché volontaire du carbone). Cette entité sera responsable de l’approbation des projets, de la supervision du registre national et de la coordination avec les acteurs internationaux.
Renforcement des compétences : Investir dans la formation des experts nationaux (au sein du gouvernement, des entreprises et des ONG) sur les méthodologies de quantification des émissions, la validation et la vérification des projets carbone, la modélisation financière, le droit du carbone et les pratiques de marché.
Mettre en place un registre national du carbone : développer une plateforme pour enregistrer, suivre et “retirer” les crédits carbone émis, garantissant leur unicité et leur transparence. Ce registre pourrait être connecté à des registres internationaux (Verra, Gold Standard, CAR,…)
Accréditation des vérificateurs indépendants : mise en place d’un système pour accréditer des entités tierces indépendantes qui certifient que les réductions d’émissions sont réelles, additionnelles et mesurables, conformément aux standards internationaux.
Identifier et accompagner les projets éligibles
Identifier le potentiel : Réaliser des études pour identifier les secteurs et les types de projets ayant le plus grand potentiel de génération de crédits carbone (par exemple, protection des forêts, énergies renouvelables, gestion des déchets, agriculture durable, foyers améliorés).
Soutenir les développeurs de projets et soutenir le contenu local : Mettre en place des mécanismes pour aider les porteurs de projets locaux (entreprises, ONG, communautés) à comprendre les exigences du marché, à élaborer des projets bancables et à naviguer dans le processus de certification. Cela peut inclure de l’assistance technique, des fonds d’amorçage ou des subventions.
Assurer les co-bénéfices : Encourager les projets qui ne se contentent pas de réduire les émissions mais génèrent aussi des avantages sociaux et environnementaux (création d’emplois, protection de la biodiversité, amélioration de la santé, développement rural). Ces “co-bénéfices” augmentent la valeur et l’attractivité des crédits.
Promouvoir le marché et attirer les investissements, le Branding national de Guinée
Marketing et communication : Promouvoir le potentiel du pays auprès des investisseurs nationaux et internationaux, des entreprises cherchant à compenser leurs émissions, et des acheteurs de crédits carbone.
Partenariats stratégiques : Chercher à établir des partenariats avec des acteurs clés du marché international du carbone (développeurs de projets internationaux, courtiers en carbone, standards de certification comme Verra ou Gold Standard, acheteurs institutionnels).
Faciliter les transactions : Mettre en place des plateformes ou des mécanismes pour faciliter l’achat et la vente de crédits carbone, en assurant transparence et équité des prix.
Accès aux financements : Travailler avec des banques, des fonds d’investissement et des institutions financières internationales pour débloquer des financements pour le développement de projets générateurs de crédits.
Suivi, Évaluation et Adaptation
Système de mesure, rapportage et vérification (MRV) : Mettre en place un système robuste pour suivre les émissions, les réductions et la performance des projets, et assurer une vérification régulière par des entités indépendantes.
Transparence : Publier régulièrement des rapports sur l’état du MVC (marché volontaire de carbone), les projets certifiés, les crédits émis et les revenus générés, pour renforcer la confiance et la crédibilité.
Contribution des communautés locales
Protection de la biodiversité et des services écosystémiques : En finançant la conservation et la restauration des écosystèmes (forêts, mangroves, sols), les projets de crédits carbone contribuent à préserver la biodiversité, à améliorer la qualité de l’air et de l’eau, à prévenir l’érosion des sols et à renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique (inondations, sécheresses).
Amélioration des moyens de subsistance : Les revenus du crédit carbone peuvent servir à financer des activités économiques alternatives ou complémentaires, réduisant ainsi la dépendance des communautés vis-à-vis d’activités non durables comme la déforestation.
Investissement dans les infrastructures sociales : Les revenus générés peuvent être utilisés pour financer des projets communautaires essentiels. Cela inclut la construction d’écoles, de dispensaires, de puits pour l’accès à l’eau potable, l’électrification rurale avec des énergies renouvelables (solaire, biogaz), ou la mise en place d’infrastructures de transport. Ces investissements améliorent directement les conditions de vie et le bien-être des populations.
Plusieurs pays africains ont pu bénéficier des crédits carbone. Le Rwanda a signé un accord avec Singapour sur le Marché Carbone en mai 2025 dans le cadre de l’Article 6 de l’Accord de Paris. C’est un partenariat pionnier, notamment pour Singapour, car il s’agit du premier accord de ce type avec un pays d’Afrique de l’Est.
Ce pays africain et allié de la Guinée n’est pas à sa première action, il a également signé un protocole d’accord (Memorandum of Understanding – MoU) avec l’Agence suédoise de l’énergie (Swedish Energy Agency) pour coopérer sur la mise en œuvre de l’Article 6 de l’Accord de Paris. Cet accord a été signé en octobre 2024.
Toujours en Afrique de l’Est, une enchère sur le crédit carbone a eu lieu à Nairobi, Kenya, le 14 juin 2023, et a été organisée par la Regional Voluntary Carbon Market Company (RVCMC), une entité lancée par le Fonds d’Investissement Public (PIF) et le groupe Saudi Tadawul d’Arabie Saoudite. Le volume record de 2,2 millions de tonnes de crédits carbone ont été vendus avec succès lors de cette enchère. Cela a dépassé le précédent record détenu par la RVCMC elle-même, qui avait vendu 1,4 million de tonnes en octobre 2022.
Nous pourrions citer d’autres exemples en Afrique pour illustrer tous les avantages à tirer de la mise en place d’un marché carbone forestier et l’institution d’une gouvernance capable de le développer. Les retombées économiques en faveur des communautés, de la société civile, des entrepreneurs et de l’Etat guinéen ne sont plus à démontrer.
D’une part, il est crucial que nous (la Guinée) développions des cadres juridiques et réglementaires solides, renforcions les capacités institutionnelles et veillions à ce que les droits et les intérêts des communautés locales soient protégés.
D’autre part, le minerais extrait de SIMANDOU produit moins de GES grâce à sa haute teneur en fer. La réduction des émissions dans l’aciérie est un bénéfice indirect de l’exploitation.
Pourrait-on la monnayer un jour ? La réponse fera l’objet d’une autre réflexion….
A défaut d’inventer la roue, nous devrons être capables de s’en inspirer, de l’adapter à nos routes et la monter sur le véhicule du développement.
Amara Camara, spécialiste en financement de crédit
L’article Développement durable : quand la forêt guinéenne est un réservoir de crédits carbone est apparu en premier sur Guinee360 - Actualité en Guinée, Politique, Économie, Sport.
.png)
 il y a 6 mois
215
il y a 6 mois
215






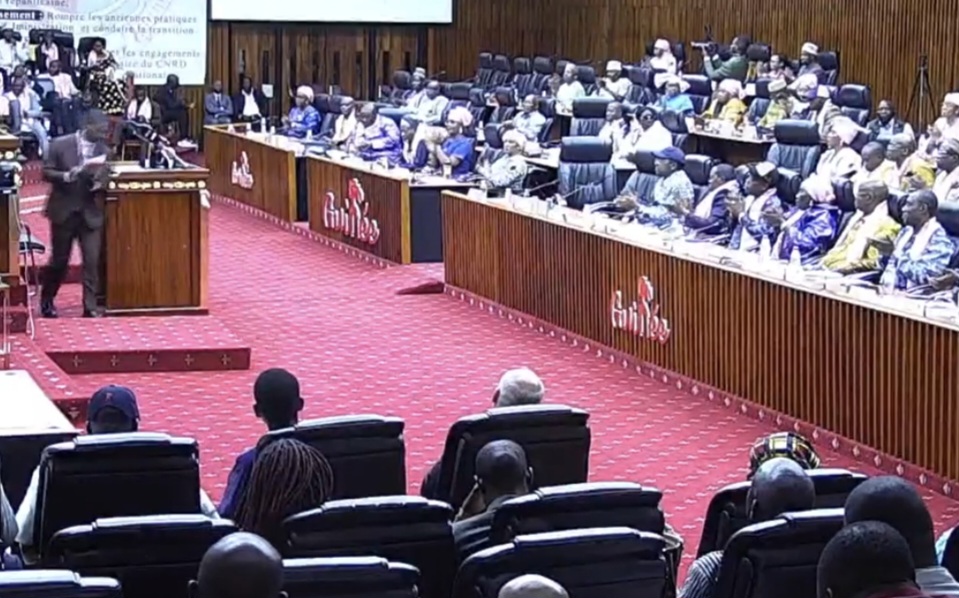











 English (US) ·
English (US) ·